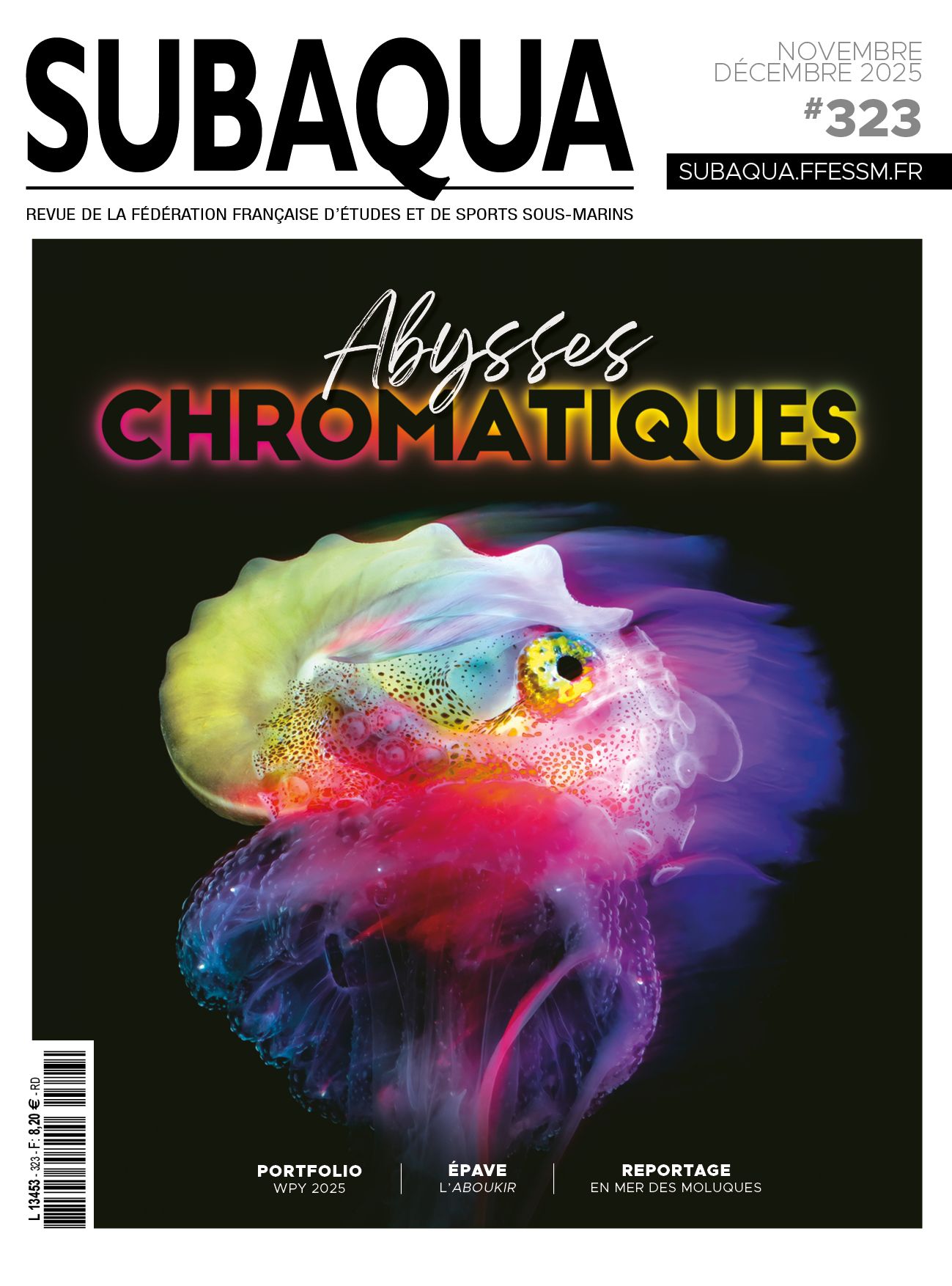PLONGÉE SOUTERRAINE EN France HISTOire ET PERSPECTIVES


Le nombre de plongeurs souterrains de loisir représente au plan mondial un véritable marché qui permet la fabrication et la diffusion à une échelle industrielle des matériels et des techniques. Sur ce terrain comme ailleurs, le nombre fait loi et c’est évidemment les productions nord-américaines qui dominent le monde, éventuellement par l’entremise de leurs sous-traitants européens. Il n’en a pas toujours été ainsi et il importe de revenir sur les origines de notre activité et prendre conscience du chemin parcouru et de l’apport des pionniers.*
L’âge de cuivre et les premiers pas
La plongée la plus ancienne en France fut celle du Marseillais N. Ottonelli, (mars 1878), en scaphandre lourd, qui descendit à Fontaine de Vaucluse, jusqu’à - 23 m. La barque de ses assistants est toujours en place dans la vasque. Avec l’apparition du système Le Prieur, l’homme se libère enfin d’une alimentation en gaz provenant de la surface. Suite et grâce à la Seconde Guerre mondiale, les progrès en matière de matériels et de techniques de pénétration dans le milieu subaquatique permettent, enfin, de plonger en scaphandre autonome dans le milieu souterrain noyé.
Le 27 août 1946, une expédition du Groupe de recherches sous-marines de Toulon (GRS), est organisé sur la Fontaine de Vaucluse. Les plongeurs de l’équipe (où se trouvent notamment J.-Y. Cousteau, Dumas et Morandière), plongent, encordés, à plusieurs reprises et parviennent à - 46 m. Le scaphandre Cousteau Gagnan remplace définitivement l’équipement du scaphandrier pieds lourds.
En 1957, le Clan des Tritons lyonnais, avec à sa tête Michel Letrone, met au point les bases des techniques modernes toujours en pratique : vêtement isotherme, lampes étanches, 2 bouteilles couplées avec chacune son détendeur, liaison à la surface par un dévidoir.

Le déclic
En 1964, apparaît une nouvelle génération de plongeurs motivée par la spéléologie. À Marseille, un groupe de 4 étudiants, membres de la FFESSM, poussé par C. Touloumdjian, s’attaque à Port-Miou et, avec des moyens personnels dérisoires, parvient à dépasser de 40 m le terminus de l’OFRS (280 m), soit le point 320. Ils s’inspirent des techniques mises au point par M. Letrone et utilisent la bouée pour l’équilibrage des bi 12 litres. La plongée a évolué. Les bouteilles sont en acier et les joints toriques remplacent les joints plats, peu fiables et dangereux. Mais le scaphandre ne possède pas encore de manomètres de pression et il faut tenir compte de « la réserve ».
Le Kiosque